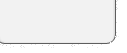Les combats de ce bicentenaire sont multiples et variés, de la Belgique à l’Espagne en passant par l’Italie et même la Suisse, la France est assaillie de tous côtés. Et si les armées alliées sont toujours aussi formidables, les confrontations concerneront souvent des effectifs plus «raisonnables» qu’en 1813, avec sous l’Empereur une forte proportion de Garde Impériale.
L’homme de l’année, côté français, soit celui qui a brillé davantage que les autres sur le plan militaire, est sans conteste Napoléon lui-même qui, seul parmi les siens, à su retrouver ses «bottes et résolutions de 1793» et redevenir le général Bonaparte.

L'Empereur est ici dépeint (détail par Laroche) à Fontainebleau le 31 mars 1814, alors que la chute de Paris est consommée et que les mauvaises nouvelles se succèdent. Il est seul, absolument seul avec ses pensées qui s'entrechoquent. Mais comme dit le proverbe, "il vaut mieux être seul que mal accompagné". Bientôt tout son entourage chamarré, maréchaux couverts de titres en tête, viendra faire pression sur l'homme accablé pour le pousser à l'abdication. Mais le pire était encore à venir...
Et au titre de ce pire nous aurions pu distinguer, étant donné leur rôle décisif dans l’issue du «match», deux hommes d’élite, deux grands dignitaires de l’Empire qui, en marquant délibérément contre leur camp le but de la victoire des Alliés, amenèrent le plus grand capitaine de tous les temps à renoncer à son trône sans livrer le dernier combat qu'il aurait probablement gagné.
J’ai nommé le Vice-Grand-Electeur Talleyrand, prince de Bénévent, et le Maréchal Marmont, duc de Raguse, mais il s’agit de considérations «civiles» pour le premier et si viles pour le second que je préfère les oublier.
Diégo Mané