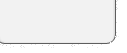.../...
Bon, je suis arrivé à les déposer !
Le premier est en travers, mais il est là, c'est déjà çà !
Tous sont tronqués à droite, mais il doit y avoir moyen de voir tout en tripotant je ne sais pas quel bouton de vos claviers.
J'inclus les commentaires qui les accompagnaient.
Diégo Mané
-------------
TL : Une photo de "mon" d'Elbée de Trent, mis sur base ronde avec deux figurines Touller (et le guidon général historique de l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou selon Crosefinte dans son ouvrage).

--------------
DM : ici les premiers "sortis" de la Légion du Nord, infanterie et cavalerie...


----------------
DM : Ici un état-major républicain dont j'ai égaré le commentaire d'accompagnement...




----------------
TL : J'ai profité d'un peu de vacances pour finir de peindre ma Légion du Nord (2 photos) ainsi qu'une brigade de hussards (12 figurines en tout; 8e et 9e de hussards).


---------------
... deux photos de mes figurines de 1793 que j'ai déjà peintes: la Légion du nord, éclairée par les 8e et 9e de hussards, va avoir fort affaire face aux Vendéens qui les attendent de pied ferme (il y a pêle-mêle, des soldats de Bonchamps, de Stofflet, de la cavalerie sous Talmont et de l'artillerie sous Marigny).
P.S. :J'ai une table de jeu qui fait 3m sur 2m