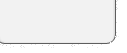D’abord, cette lecture qui fait suite au volume 1 que j’ai exploité dans mon ouvrage « la guerre russo-suédoise de 1808 » afin de comprendre les tactiques russes. Dans le volume 2, on a une image assez précise, et basée sur des écrits théoriques mais surtout de nombreux témoignages, de l’évolution théorique et psychologique russe issue à la fois du combat contre les Français et contre les Suédois.
En lisant cet ouvrage, j’ai été très surpris de voir une énorme différence entre ce que l’on m’avait dit et expliqué sur cette armée tsariste et les écrits russes qui sont souvent plus critiques que l’on pourrait le penser.
Je vais vous présenter ces éléments par armes et je finirai en présentant la vraie tare de l’armée russe : son haut commandement. La garde est certes un élément à part je ne l’analyserai que de façon très succincte car les échanges avec les troupes de lignes sont permanents et continus. Je n'analyserai pas aussi les cosaques (rapidement présentés).
L’infanterie.
Arme de base organisée en trois groupes :
infanterie lourde (régiments de grenadiers),
infanterie de ligne
infanterie légère.
Toutes les trois (et à l’exception de la Garde) sont constituées de la même façon : 8 pelotons, dont deux d’élite formant 4 compagnies dont une d'élite.
Chez les Grenadiers, dont seule la compagnie d’élite à droit à ce nom, les compagnies du centre sont constituées de « Fusiliers ».
Dans l’infanterie de ligne, les compagnies du centre sont constituées de « Mousquetaires » et dans l’infanterie légère, elles sont constituées de « Chasseurs ».
Le rôle de cette compagnie d’élite est à la fois « d’encadrer » la ligne mais aussi de couvrir le bataillon, notamment pour l’écran de tirailleurs (cela pour les deux pelotons). Les témoignages écrits dans l’ouvrage montrent une pratique assez développée et se systématisant au fil du temps dans ces rôles. D’après les auteurs, l’expérience finlandaise a été un élément clé dans ce développement.
Du point de vue tactique, les unités russes utilisaient beaucoup la colonne mais aussi énormément encore la ligne. Il arrive souvent (cela m’est aussi confirmé par d’autres sources) que l’ordre mixte soit utilisé. Cela vient du changement de concept de l’utilisation des armes : le feu devient la chose primordiale à développer (Kutuzov et Barclay de Tolly), mais cependant les problèmes économiques réduiront les entraînements au feu (à l’exception des élites et des légers) au strict minimum. Cette tactique ira en se développant d’autant que les renforts se feront rare et qu’il faut épargner l’infanterie.
Mais l’assaut à la baïonnette reste une constante des troupes, même pour les légers et cela même contre la cavalerie (les auteurs citent de nombreux exemples). Cela a une autre conséquence : la forte tendance à poursuivre un ennemi battu, en dépit des efforts des officiers, y compris les plus agressifs comme Bagration.
La cavalerie (hors cosaques)
C’est l’arme de la noblesse mais c’est surtout l’arme la plus mal aimée de l’armée russe, y compris dans les hautes sphères militaires. Les commentaires très critiques du Tsar en 1812 et 1815 montrent un élément de scepticisme auquel je ne m’attendais pas. Les témoignages des officiers des autres armes (infanterie et artillerie) montrent une défiance très forte envers la cavalerie.
L’analyse faite montre une arme qui n’a pas vraiment bougé par rapport aux périodes précédentes dans son comportement, dans sa manœuvre (le règlement de 1796 est toujours en vigueur) et surtout dans son commandement (le plus mauvais de l’armée d’après le Tsar en personne). La seule réelle modification est dans la constitution des unités (réduction du nombre d’escadrons par régiment). A ma grande surprise, la formation de base de combat de la cavalerie est la ligne de régiment (ou de demi-régiment, appelé bataillon) car elle combat toujours sur deux lignes.
Enfin, les auteurs montrent que la cavalerie, même la légère, refuse la poursuite car l’objectif obsessionnel est de ne pas perdre sa formation. Cela provoque le repli rapide de ces troupes en deuxième ligne pour se reformer. Ce n’est pas parce que l’on se décharge sur les cosaques, c’est parce que les cadres ont peur de la dispersion de leurs troupes.
D’autre part, dans cet ouvrage, les dragons russes ont les chevaux les plus petits de l’armée russe. Ce sont les lanciers qui ont le rôle de cavaliers de bataille.
L’artillerie
C’est l’arme principale de l’armée russe, mais elle n’est plus insacrificiable. Dès 1812, le Tsar indique que le sang des hommes est plus important que le matériel. Le comportement des artilleurs russes en 1812 montre ce changement : le repli des servants devant une menace non arrêtable est répétée, car c’est l’infanterie qui va contre-attaquer qui reprendra les pièces !
En théorie, selon Khatov et Gogel, c’est une arme de soutien, mais dans la pratique et en raison du comportement de nombreux généraux, ce sont les autres armes et surtout l’infanterie qui doivent la protéger.
C’est l’arme qui à le plus copié son modèle, l’artillerie française, surtout dans sa mobilité et sa manœuvre, même si elle a toujours un énorme défaut : il n’existe pas d’école d’artillerie (je croyais qu’elle en avait une !
Le haut commandement
C’est le plus grand problème de l’armée russe, car outre les conflits récurrents entre « étrangers » et « russes », il y a des luttes entre personnes qui sont très fortes. De plus, l’influence familiale compte énormément .
Le Tsar, même si son impact est très variable, domine toutes les décisions. La nomination de Wittgenstein après la mort du maréchal Kutuzov en mars 1813 est typique de l’influence de cours dans les décisions impériales.
Trois autres éléments que j’ai découvert dans cet ouvrage ont une influence énorme sur le déroulement des batailles et ils expliquent nombre de déconvenues russes et aussi pourquoi les Prussiens ont pris historiquement le dessus sur les Russes dans les victoires de 1813 :
Ludiquement